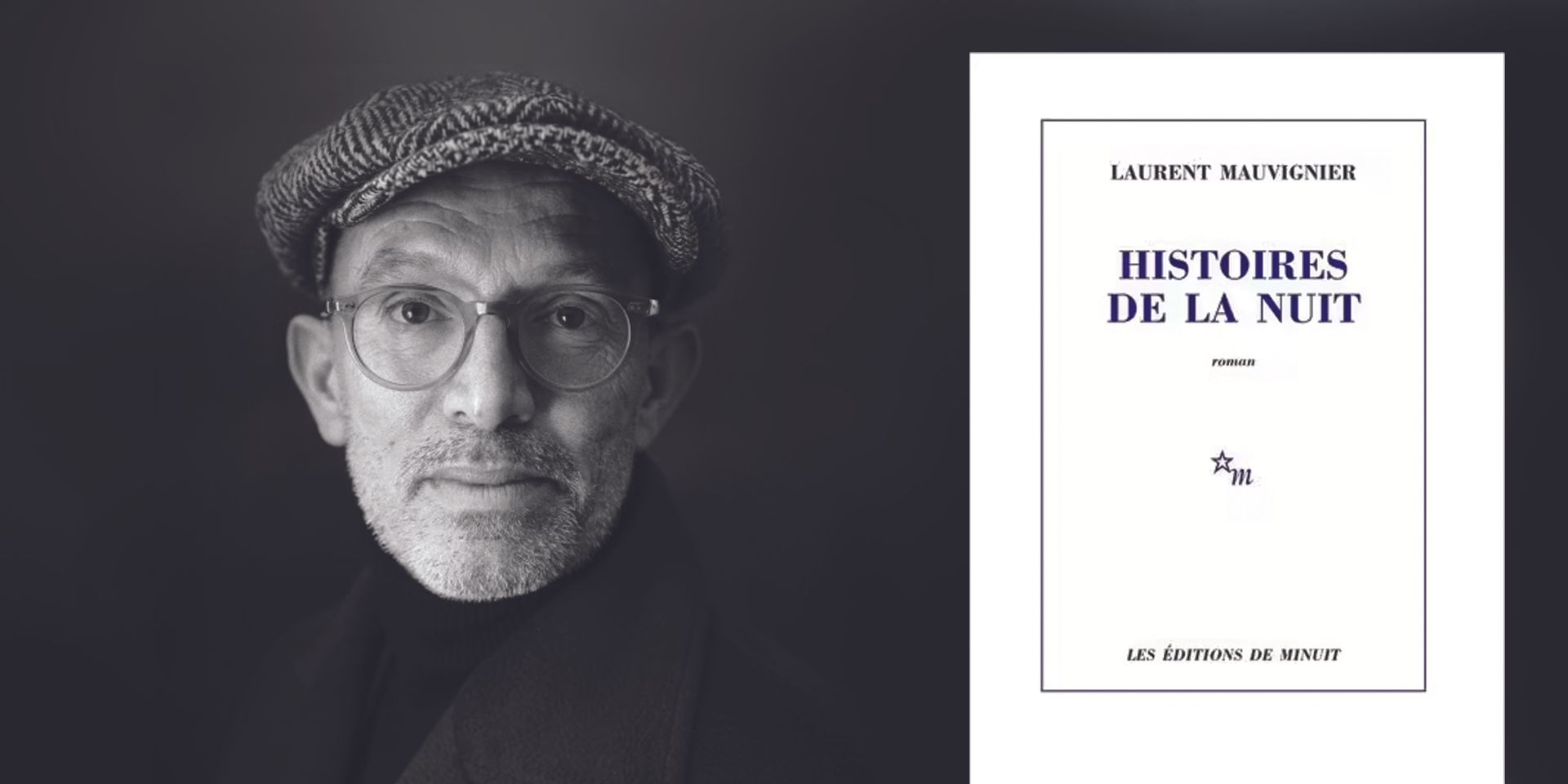“Que peut Littérature quand elle ne peut ?” de Patrick Chamoiseau
C’est toujours intéressant, au regard de la production littéraire actuelle, de mettre un écrivain en face de la question des fonctions de la littérature elle-même : ça permet de savoir quelles ont été ses lectures, les conditions qui les ont déterminées. Patrick Chamoiseau est un écrivain de la minorité, des opprimés de toutes sortes : c’est le préalable de l’essai (Que peut Littérature quand elle ne peut ?) qu’il sort aux éditions du Seuil, dans la collection Libellé.
Un court essai issu d’un discours qu’il devait faire à Strasbourg en 2024, pour un colloque intitulé Lire le Monde, auquel il n’a finalement pas pu participer. Il en a gardé la structure pour interroger le rapport au monde des littératures, puisqu’il convient de les multiplier pour mieux les singulariser. Son postulat, c’est qu’il n’y a pas de littérature sans considérer toutes les oppressions, et sa liste est longue des peuples nations effacés, des Palestiniens aux Ouighours. Potentiellement, ça peut d’entrée tendre le lecteur (moi) qui s’est placé depuis longtemps du côté de Camus dans le discours de Suède après avoir d’entrée suivi Sartre, par impulsion. Mais puisque Chamoiseau sait ce dont il parle, qu’il en a fait le cœur de sa littérature propre—Il n’y a pas de mémoire, mais une ossature de l’esprit, sédimentée comme un corail, sans boussole ni compas, écrit-il dans Une enfance créole. Antan d’enfance (Gallimard, 1996)—puisqu’il s’est lui-même plongé dans les récits d'abbés savants et les écrits d'anonymes, de marins pour questionner une historiographie coloniale, la curiosité prédomine. Et se voit bien servie : puisque la littérature est chargée d’émancipation vers l’aurore des devenirs du monde face à un imaginaire capitaliste qui réifie la Terre et abîme le Monde, il faut user d’une conscience désormais individuée, dit-il en sollicitant Césaire pour que l’impérieuse nécessité de ne pas l’accepter reprenne le dessus. Il cite Hölderlin pour sa question à quoi servent les poètes en ces temps de détresse, Adorno pour celle d’écrire après Auschwitz, interroge l’emmêlement indépassable de l’humain et de l’inhumain et s’étonne—faussement—que nos littératures soient devenues étrangement anodines, inoffensives, silencieuses, liées à la loi du Marché. Démontre que les vieux canevas du roman et de l’anti-roman ont fait place à des formes ouvertes, transversales, qui ne brisent plus la mer gelée en nous, attendait Kafka de ses lectures.
Chamoiseau n’est pas Jourde, il ne va pas donner les noms de ces romanciers paresseux (dommage) dont chaque ouvrage est un fardeau supplémentaire posée sur les épaules fatiguées d’une littérature qui pensait qu’on apprendrait de ses maîtres. Discours réactionnaire ? La réflexion de Chamoiseau est (beaucoup) plus large, se fait ethnologique : selon lui, Édouard Glissant—Prix Renaudot 1958 pour La Lézarde, finaliste du Nobel 1992—a déjà démontré la créolisation globale du monde, depuis que la découverte du Nouveau-Monde s’est transformée en Tout-Monde et s’est imposée à nos esthétiques. Pour Chamoiseau, il faut revenir à la joie—spinoziste en cela que la joie elle-même, en tant qu'elle n’est plus seulement un plaisir parmi d'autres, quelque chose qui vient satisfaire une de nos souffrances, est un plaisir total qui vient satisfaire l'ensemble de notre être, quand on y parvient—retrouver le poète véritable, le Conteur primordial, celui pour qui chaque homme est avant tout des familles des amis des rêves des idéaux de combats des lieux des peurs et du désir, le tout sans ponctuation.
Patrick Chamoiseau met en parallèle l’Imaginaire de la Relation avec l’Ouvert d’Hölderlin, encore, les possibles retrouvés au vif de l’Impossible, écrit—via ses notes de sentimenthèque, fil conducteur de l’essai—que c’est le communisme qui a affuté la poétique de Neruda, que le colonialisme a stimulé Kipling, la fureur raciste exalté Céline, etc. Il énumère les fastes de l’indicible, dit de la domination qu’elle a fait disparaître la Beauté, celle de Dostoievski. Sollicite—son autre raison de vivre—les jazzmen américains, tous mystiques ou religieux, habités par l’origine de la souffrance de leur aïeux dans les champs de coton. Il aspire à des puissances narratives nouvelles, raconte comment Michel Butor a résisté à l’invitation de Thor Vilhjálmsson, auteur des Nuits à Reykjavík, chez lui, jusqu’à ce qu’il lui raconte qu’en Islande, ils étaient 300 000 le jour, mais plus de 800 000 la nuit, une fois les elfes sortis. J’arrive, a répondu à ces mots l’auteur de la Modification, père du Nouveau roman.
En filigrane, dans cet essai, on trouve Don Quijote, dans l’idée d’élaborer en solitaire son éthique du vivre. Cervantes m’a éclairé Rabelais et Villon et Faulkner me les a renouvelés, écrit Chamoiseau, pour mieux dénoncer, dans le même temps, un ethnocentrisme européen dans l’idée de l’invention du roman—lequel s’appuie tout autant sur des griots africains, des conteurs créoles ou des hommes des poussières nomades. Il évoque les glorieuses défaites que sont aux yeux des grands romanciers (Faulkner, Kundera, Joyce, Proust…) leurs réussites les plus marquantes. Cette réflexion sur les littératures, qu’on comprend mieux sous l’angle de l’individuation (le Je) liée à la problématisation du Nous, via l’émancipation des identités minoritaires, les cultures composites, compose l’idée d’un organisme narratif visant à ce que la Personne s’accomplisse dans une constellation de Nous. Ce pourrait être un vœu pieux, c’est un brulot sur l’idée d’un art qui s’est refermé sur son industrie et ne s’inscrit plus dans une linéarité du temps, celle qui rend les (grands) auteurs intemporels, justement.
Il faut aimer les littératures et les essais pour livre ce (petit) livre, souffler un peu à l’idée de ne pas se sentir tout seul face à l’océan de la production, souvent médiocre. Que peut lecture quand elle ne peut ?
Que peut Littérature quand elle ne peut ?
Patrick Chamoiseau
Éditions Seuil Libellé (2025)