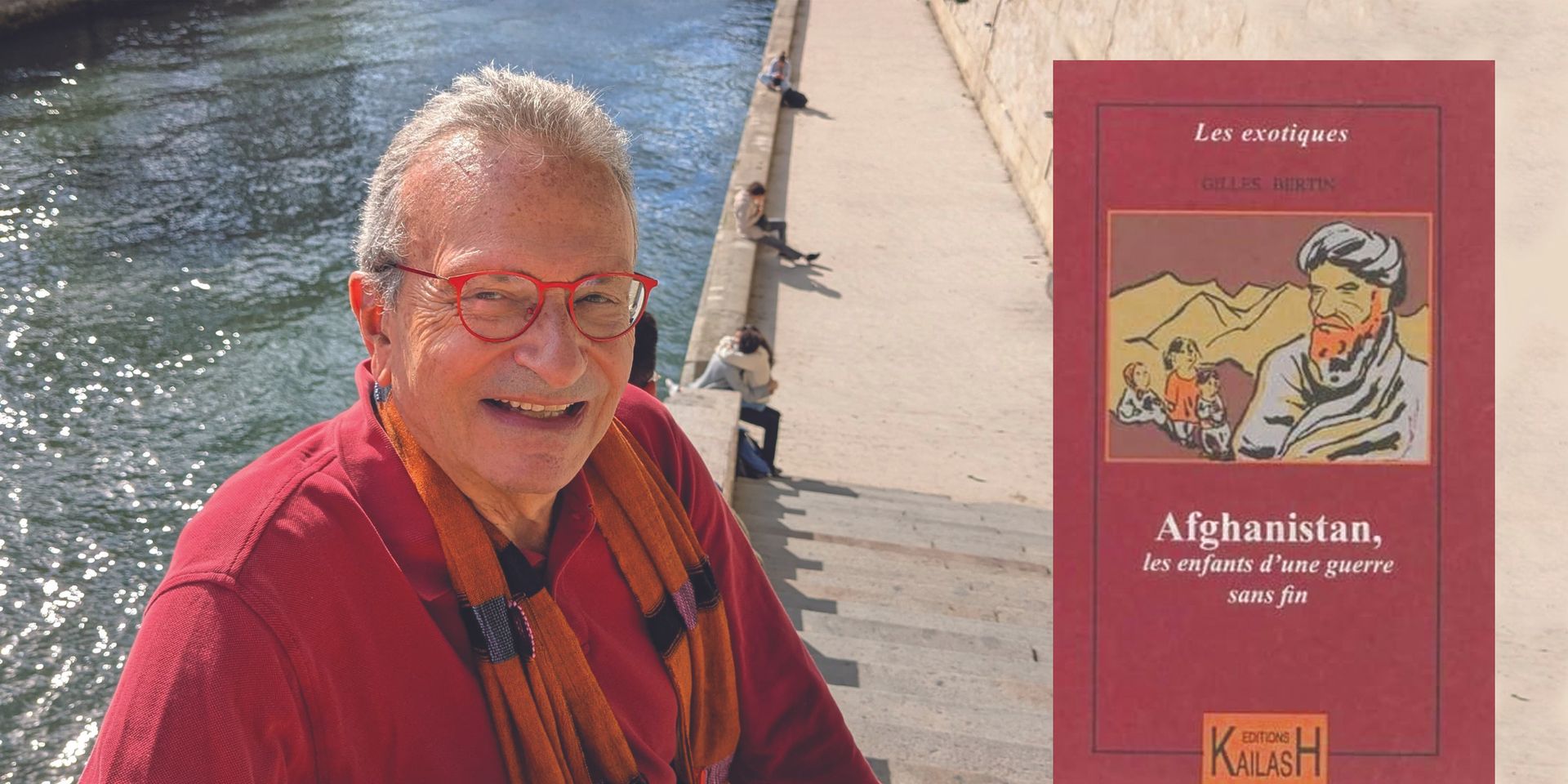“Folie” de Gilles Verdet
— T’as un grain ?
Comment savoir ? La folie n’existe que dans le regard des autres. Les tics, les tocs et les trucs
obsessionnels, on les remarque parce qu’ils nous dérangent… Pas les pensées vagabondes qui viennent
de nulle part et se barrent ailleurs. Le vent de folie qui les emporte, personne ne sait comment il
tempête en nous. Moi c’est la mer que j’ai en moi. Je l’ai en moi depuis si longtemps.
— Un grain ?
Je pourrais lui parler de la semence, de l’origine de la plante, de l’arbre et des fruits. Dire que le
grain est la genèse de tout. De la naissance et de la vie. Un grain suffit, un seul. Celui du sel qui donne
le goût à tout ou celui du sablier qui mesure le temps comme roulent sur la plage les grains serrés de
toutes nos envies.
— Regarde l’étang !
Je lui montre le plat qui frémit, sa peau satinée qui frissonne.
On s’allonge. Là, où l’étang s’étale, se tend et s’étend lascivement. Protégeant de nacre ses dessous
affriolants. Sans les voir, je sais qu’ils sont là, dans la lumière basse du jour tombant. Là, plein de lingeries
aquatiques et de dentelles aguicheuses. Je sens remonter de la pénombre, la flore vénéneuse du désir,
germée dans la fange et le limon des profondeurs. Dans la blême obscurité des courants, j’imagine
des fleurs marines aux parfums d’huitre, des corolles béantes ouvertes aux lècheries, des bourgeons
de velours, des dédales de pétales. Des calices, des étoiles et des papillotes végétales. J’entrevois,
sous des bouquets d’algues enlacées, des bans entiers de bêtes heureuses, une faune affamée de jouir,
des méduses câlines, des loups vifs en maraude et des serpents de mer tendus comme des phallus à
l’excite.
J’ai le regard happé par le soir qui tarde. Maintenant, le temps s’attarde aux heures d’été. L’esprit
divague. Des vagues minuscules sourdinent. Leurs claquements sourds s’estompent, aussitôt ébauchés,
aussitôt oubliés.
Le calme s’affiche à plein temps, le coton de l’air s’installe, l’eau s’aplatit. Les contours s’élargissent
jusqu’au bout des yeux et les yeux s’étrécissent, éblouis, ébahis de grand. Car tout devant s’agrandit.
Tout s’amplifie dans un champ sans limite, une étoffe liquide, lissée de gris et veloutée de doux. Je
vois dans l’alentour, de quoi somnoler à perpète. Me vautrer dans le tendre. Me rouler et m’affaler
sur la croupe lubrique de l’étal. Ici, où se dessine le faux plat de ton dos, le fourreau de tes reins,
le plateau tremblant de ton ventre, jusqu’au bord humide de tes lèvres. J’y retrouve le friselis de ta
chair, le tremblé du duvet, le grainé de ta peau. Un allongé de désir où dormir à n’en plus finir, baiser
jusqu’à plus soif la rive claire de tes fesses, la frise de ton cul, la fraise de ton con. J’arpente des yeux
le drap tiède d’un plumard démesuré, une toile couchée de maître flamand, un drapé horizontal de
satin sombre, une couche de fraîcheur, étalée là pour s’y étendre, de long en long et de large en large.
L’étang s’étire.
Opale, pâle et fascinant. Sa panse s’alanguit, charnelle, interminable.
Au bord, j’arpente le bois du ponton qui se perche au-devant. Le plain vacille à peine. Il ne tremble
plus. La mer, pourtant, n’est pas si loin. L’étang lui a volé le meilleur du large et rapporte ici
les derniers sentiments heureux de la fin des heures. L’impensable sérénité des tourmentés, la
quiétude des assoupis, la nonchalance retrouvée des assouvis. Toutes les émotions perdues accostent
ici, au bout des planchers alignés, pour régaler les croqueurs de vie, les bouffeurs de coquillages et les
buveurs de vin glacé.
Au fond, se fond le fond du jour dans un fond de teint teinté de clair. Le crépuscule attendra, je le
repousse comme on se garde d’éteindre son chevet pour jouir encore un peu d’un livre qui met l’esprit
ailleurs. Ses pages s’ouvrent sur une soûlerie intérieure, une illusion d’illusion qui me plonge dans un
océan de débauche paisible et m’entraîne vers des bacchanales de rêveries irraisonnées.
Et puis.
Le jour pétille encore de proche et le lointain allume la colline de Sète. Saint-Clair brasille. La
lagune miroite. L’horizon ne demande qu’à s’enflammer. L’eau se teinte d’ardoise et de plomb fondu.
Face aux mazets qui s’encombrent d’affamés, les pics, les piquets et les picots des gaveurs d’huitres
émergent doucement, telles des dents de monstres marins, des chicots pointés au ciel comme une
défense maritime contre toutes les avanies terrestres.
Il est tard. L’étang se sape maintenant de sombre pour la sortie du soir. Un costard de saison qui
sent l’encanaillerie et les lampions flottants. Aigrettes et goélands rageurs, mouettes rieuses, hérons
ronchons et cormorans contents battent l’aile de la retraite. Ils attendront l’aube prochaine pour
recouvrer leur terrain de jeu. Mais là, la nuit est pour nous, la bise emporte le fumet des brasucades,
le tintement des verres, les parler bas et les confidences inutiles. Passe au large, le dernier crincrin
d’un canot plat, son bruissement chuinte et s’efface. Son fil d’écume disparait plus vite qu’un trait de
plume. À présent tout se gomme et tout se rature au rivage. Les bruits du jour, les rires de niards, les
gueuleries des oiseaux de mer. Même le vent aux cheveux cesse ses agaceries.
Reste plus que toi. Et toi, tu m’entraînes en plongeant vers les jardins immergés d’Aphrodite, les
prairies de fucus de Vénus, les cavités sous-marines des sirènes affolantes, là, dans la petite nuit des
closeries fleuries d’astres marins, de vies minuscules et de ritournelles lacustres. Tes bras sont mes
ailes. Je suis le mareyeur insatiable des sirènes, égaré sur un lac de mélancolie. Je nage en apnée, entre
deux eaux, au mitan des feuillages lumineux et des filaments de soie. Là dans l’apesanteur de l’entre
soi et les senteurs entêtantes de mucus salé. Là dans le tréfonds où tout se fond.
Où tout se confond.
Là, dans notre chambre d’hôtel perdue, où les yeux grands ouverts sur une vieille photo jaunie, je
m’endors. Je m’endors entre tes bras…
Gilles Verdet